Défendre l’anonymat sur internet avant qu’il ne soit trop tard

Ils prétendent vouloir lutter contre “la haine en ligne” et vouloir “protéger les mineurs”. Ils disent que l’anonymat sur internet n’existe pas, et qu’il n’y a que du pseudonymat. Ils vous mentent.
Il n’existe pas un anonymat, mais des degrés d’anonymat
L’idée selon laquelle l’anonymat serait soit absolu, soit inexistant est une fausse dichotomie.
En réalité, l’anonymat peut être partiel ou total, temporaire ou durable, technique ou juridique. Il est gradué, contextuel et fonctionnel.
On confond souvent quatre notions :
– Le pseudonymat : il consiste à utiliser un alias (pseudonyme) au lieu d’un nom réel. C’est une forme d’anonymat relative, qui protège tant que le lien entre le pseudonyme et l’identité réelle n’est pas établi. C’est la norme sur les forums et les réseaux sociaux.
– L’anonymat proprement dit : il désigne l’absence d’identifiants civils ou techniques permettant de remonter à une personne. Cela peut être renforcé par des outils comme Tor, des VPNs ou des systèmes de messagerie décentralisée. Il est difficile à garantir de manière absolue, mais il peut être suffisamment robuste pour protéger une activité ou une expression.
– La traçabilité : c’est la capacité technique de reconstituer une action passée à partir de métadonnées, de journaux de connexion ou d’empreintes numériques. Traçable ne veut pas dire identifié, mais cela crée une vulnérabilité potentielle à l’anonymat si des corrélations sont faites.
– La responsabilité légale : elle commence à partir du moment où une autorité parvient à lever l’anonymat, par voie judiciaire (réquisition auprès d’un fournisseur, perquisition numérique, etc.). On n’est pas “responsable par défaut” sur internet ; c’est la levée de l’anonymat qui crée un pont vers le droit pénal ou civil.Cette confusion sert à justifier des mesures de surveillance en prétendant qu’elles ne changent rien, puisque “personne n’est vraiment anonyme de toute façon”.
“L’anonymat n’existe pas sur internet”
On entend souvent que “l’anonymat n’existe pas sur internet” et qu’il ne s’agit que de “pseudonymat”.
Les personnes qui utilisent ce mot ne comprennent pas son sens.
Le pseudonymat est une forme d’anonymat. Certes partielle, mais bien réelle.Il consiste à dissocier une identité civile (nom légal) d’une identité en ligne (pseudonyme), créant ainsi une couche de protection.
Tant qu’aucune faille technique, erreur humaine ou procédure judiciaire ne permet de remonter à la personne derrière un alias, l’utilisateur est, de fait, anonyme dans la pratique.
Des millions d’individus s’expriment sous pseudonyme sans pourtant être identifiés. Par exemple :
- Julian Assange (Wikileaks) a utilisé de nombreux pseudonymes dans les années 1990, notamment sur les forums de hacking.
- Satoshi Nakamoto, créateur de Bitcoin, demeure à ce jour anonyme malgré des enquêtes intensives.
- Banksy, figure emblématique de l’art urbain, n’a jamais été formellement identifié malgré des décennies de notoriété.
- Des milliers de journalistes, notamment dans des régimes autoritaires (Iran, Russie, Chine), publient sous alias pour éviter la répression.
- Sur X (Twitter), de nombreux comptes influents, y compris dans les domaines politique et économique ne sont associés à aucune identité civile connue.

"Si tu n’as rien à te reprocher, tu n'as pas besoin d'être anonyme"
C’est l’un des discours les plus fréquemment mobilisés pour justifier la surveillance et la levée de l’anonymat. Il repose sur une inversion dangereuse des principes démocratiques.La vie privée est un droit, pas une faveur. Elle n’a pas à être “justifiée”. Elle est reconnue par les textes fondamentaux :
- Article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
- Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
- Article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Ce n’est pas à l’État de présumer la culpabilité de celui qui protège sa vie privée. L’exercice d’un droit ne saurait être considéré comme un indice de mauvaise intention. Accepter l’idée inverse, c’est considérer toute protection de son intimité comme suspecte. ce qui est le fondement des régimes autoritaires.
Les personnes qui ont “tout à perdre” de la transparence sont aussi celles qui ont le plus besoin de l’anonymat :
- lanceurs d’alerte
- dissidents politiques
- journalistes d’investigation
- activistes menacés
- citoyens vivant sous des régimes oppressifs
- victimes, ou personnes souhaitant se protéger de représailles personnelles ou professionnelles
Tout le monde a une vie privée à protéger. Tout le monde a déjà menti. Parfois par prudence, parfois par maladresse, parfois par nécessité. Ce n’est pas le sujet. Ce qui importe, c’est que chacun a droit à une sphère intime. Un espace mental, émotionnel, affectif, qui n’appartient qu’à lui.
Vous n’avez pas envie, et vous n’avez pas à accepter, que vos proches, vos collègues, votre employeur ou votre entourage sachent ce que vous pensez réellement d’eux, les moments où vous les avez critiqués, vos préférences, vos souvenirs et vos fantasmes les plus secrets.
Ce n’est ni honteux, ni suspect. C’est humain. La vie privée, c’est le droit de choisir ce que l’on partage, avec qui, dans quelles conditions.
De plus, les dispositifs de levée systématique de l’anonymat ne dissuadent pas les véritables criminels.Ceux-ci utilisent déjà d’autres canaux, des réseaux fermés, ou des moyens techniques avancés. En revanche, ce sont les citoyens ordinaires, honnêtes, qui cessent de s’exprimer.
"Si la justice et la police veulent te retrouver, elle te retrouveront"
Cet argument revient souvent, présenté comme une évidence destinée à invalider toute prétention à l’anonymat.
Pourtant, cette formule ne reflète ni la réalité technique, ni la complexité juridique du processus d’identification.
Dans le cadre d’une enquête judiciaire formelle, il est effectivement possible de lever un anonymat partiel. Mais cela suppose plusieurs conditions strictes :
- Une procédure légale encadrée : plainte, ouverture d’enquête, réquisitions auprès d’acteurs privés (hébergeurs, opérateurs, plateformes).
- Un coût non négligeable : les procédures judiciaires, en particulier les enquêtes numériques, mobilisent des ressources rares.
- Un temps souvent long : le traitement peut durer des semaines voire des mois, selon les coopérations internationales ou les obstacles techniques.
- Une efficacité conditionnelle : si l’utilisateur a pris des précautions (pas de données personnelles, navigation chiffrée, anonymisation IP, alias non réutilisé), l’identification peut être impossible ou juridiquement irrecevable.
La vraie question n’est donc pas « peut-on être retrouvé un jour par l’État », mais :
Peut-on s’exprimer sans que quiconque (employeur, administration, entourage, etc) puisse facilement faire le lien avec notre identité civile ?
Et la réponse est oui. C'est techniquement et légalement.
Le guide complet pour atteindre un niveau d'anonymat élevé sur internet
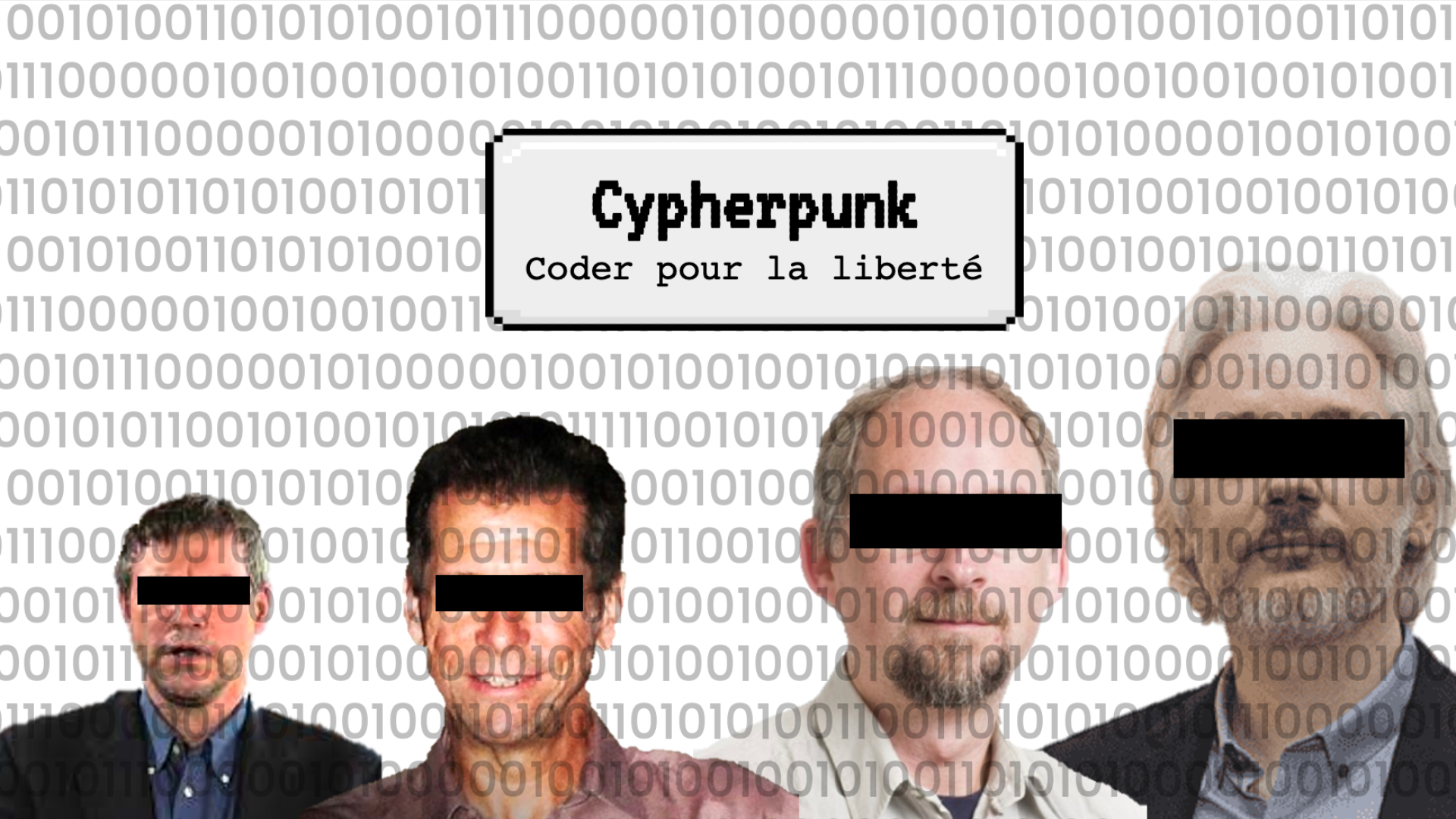
Il n’existe pas d’outil miracle. C’est la combinaison de plusieurs couches techniques et comportementales qui permet d’atteindre un bon niveau d’anonymat.
1. Comptes cloisonnés
- Ne jamais utiliser d’e-mails classiques (Gmail, Outlook…) liés à une identité réelle.
- Privilégier des services emails chiffrés comme ProtonMail ou Tutanota.
- Utiliser des gestionnaires d’alias mail comme SimpleLogin ou AnonAddy pour masquer votre adresse réelle et compartimenter vos activités.
2. Numéros anonymes
- Acheter une SIM prépayée avec des cryptomonnaies (Bitcoin, ou mieux, Monero) via des services comme Silent.Link ou JMP.chat.
- Ne jamais réutiliser un même numéro entre différents profils ou identités.
3. Masquage de l’adresse IP
- Utiliser un VPN no-log basé dans une juridiction respectueuse de la vie privée (ex. : Mullvad, ProtonVPN, IVPN).
- Pour les usages sensibles, préférer Tor Browser, qui fait transiter votre trafic par plusieurs relais chiffrés.
- Ne jamais naviguer sur internet à découvert, sans tunnel sécurisé.
4. Systèmes d’exploitation spécialisés
- Tails OS : système “live”, amnésique, à usage unique. Idéal pour les sessions ponctuelles à haut risque.
- Qubes OS : compartimente chaque usage dans des machines virtuelles isolées.
- Whonix : OS basé sur Tor, conçu pour un anonymat durable.
5. Paiements anonymes
- Utiliser Monero (XMR) pour sa confidentialité native, ou Bitcoin via des outils de mixage (ex. : Wasabi, Whirlpool).
- Éviter toute plateforme imposant une vérification d’identité (KYC) pour des usages sensibles.
- Ne jamais relier un portefeuille KYC à une activité que vous souhaitez garder privée.
6. Messageries sécurisées
- Signal reste la plus robuste en termes de chiffrement, bien qu’elle nécessite un numéro de téléphone.
- Session, dérivée de Signal, supprime cette contrainte et fonctionne sans numéro.
7. Discipline comportementale
- Supprimer les métadonnées des fichiers (images, PDF, etc.) avant publication : outils comme ExifCleaner ou mat2.
- Quand vous postez une photo : évitez de montrer des lieux reconnaissables (bâtiments, enseignes, monuments, signalétiques, etc). Méfiez-vous des ombres et du soleil, car leur position peut indiquer l’heure et l’orientation de la scène, et permettre une reconstitution via des outils de géomatching.
- Faire attention à votre style d’écriture : certains mots, tournures ou horaires de publication peuvent suffire à vous identifier.
– Cloisonnez strictement vos identités : ne jamais croiser vos comptes. Il faut utiliser des comptes séparés selon les contextes (personnel, professionnel, militant, etc).
En combinant ces précautions, tu deviens presque invisible
L’objectif n’est pas d’être introuvable dans l’absolu, mais hors de portée des méthodes classiques de traçage. En appliquant rigoureusement les bonnes pratiques d’anonymat, tu sors du champ d’action de :
- la surveillance automatisée (scrapers, indexation, tracking tiers)
- les tentatives de doxing amateur ou semi-pro
- la surveillance passive par les plateformes ou les fournisseurs d’accès
- les systèmes collaboratifs de signalement ou de corrélation
Même en cas d’enquête judiciaire, à défaut de faille opérationnelle grave (réutilisation d’un alias, négligence comportementale, erreur technique), il sera extrêmement difficile de t’identifier, juridiquement comme techniquement.
C’est cela, un anonymat fonctionnel. Il ne sera jamais absolu, mais l’objectif est de tendre vers un anonymat le plus complet possible, selon ses besoins et ses capacités techniques.
L’anonymat est de plus en plus ciblé par les États
Les outils permettant un anonymat fonctionnel ne sont pas tolérés partout. Ils sont progressivement restreints, marginalisés et criminalisés, sous couvert de sécurité, de lutte contre les contenus illicites ou de protection des mineurs.
Exemples concrets de cette tendance :
- Obligation de vérification d’identité sur les réseaux sociaux : Emmanuel Macron a proposé l’instauration d’un KYC obligatoire pour créer un compte sur les réseaux, au nom de la “protection des mineurs” et de la “lutte contre la haine en ligne”.
- Interdiction des paiements anonymes : la cryptomonnaie Monero (XMR), conçue pour garantir la confidentialité des transactions, est bannie de nombreuses plateformes (Binance, Kraken, Coinbase, etc.). Des projets de régulation européenne cherchent à imposer l’identification à tout paiement crypto.
- Censure de Tor : plusieurs pays bloquent activement le réseau Tor (ex. : Russie, Chine, Iran). En Europe, certaines voix plaident pour sa surveillance renforcée, voire son interdiction.
- Restriction des outils de chiffrement : des gouvernements occidentaux (Royaume-Uni, Allemagne, France) ont milité à plusieurs reprises pour l’interdiction du chiffrement fort sans accès étatique ou l’installation de backdoors (“portes dérobées”) dans les applications de messagerie.
- Chat Control (Union européenne) : projet de directive visant à scanner automatiquement les messages chiffrés (y compris sur Signal, WhatsApp ou Telegram) à la recherche de contenus illicites, sous prétexte de lutter contre la pédocriminalité.
- Censure ou interdiction des VPN : certains régimes autoritaires (Chine, Iran, Turquie, Russie…) bloquent les services VPN ou exigent leur enregistrement auprès de l’État. Des appels similaires émergent ponctuellement en Europe ou aux États-Unis en cas de crise.
Conclusion
L’anonymat sur internet n’est pas un mythe. Il existe des moyens concrets, documentés, reproductibles pour rester anonyme avec un degré élevé.
Adresses e-mail chiffrées, numéros de téléphone anonymes, VPNs robustes, navigateurs comme Tor, systèmes d’exploitation sécurisés, paiements décentralisés, messageries chiffrées, cloisonnement rigoureux des identités et des usages...
Aucune de ces briques n’est magique, mais leur combinaison crée un anonymat fonctionnel, suffisant pour résister à la surveillance de masse, aux algorithmes de profilage et aux pressions sociales.
Le pseudonymat, souvent mal compris, est une forme d’anonymat, certes imparfaite, mais largement suffisante dans la majorité des cas, et qui permet à chacun de s’exprimer sans exposition immédiate, de critiquer sans représailles, d’alerter sans être réduit au silence.
L’anonymat protège les citoyens. Il protège votre vie privée. Il protège vos idées. Il protège les contre-pouvoirs. Il protège la liberté d’expression nécessaire à toute société libre.
Céder sur ce terrain, au nom de la transparence ou de la sécurité, revient à créer une société où chaque expression est surveillée, chaque opinion est archivée, chaque désaccord est potentiellement suspect.
Sans anonymat, la liberté d’expression devient conditionnelle.
Sans anonymat, il n’y a tout simplement plus de liberté.
L’anonymat n’est pas l’ennemi de la démocratie, c’en est un pilier. L’anonymat est un droit fondamental.
Il permet à des lanceurs d’alerte, à des dissidents politiques, à des journalistes et à de simples citoyens de s’exprimer sans craindre de représailles.
Supprimer l’anonymat, c’est instaurer une société de la surveillance où seule une opinion conforme peut s’exprimer sans risque.
Supprimer l’anonymat, ce n’est pas protéger la démocratie, c’est en marquer la fin.
Merci.